Face à la pollution croissante aux PFAS – Substances chimiques dites « éternelles », très résistantes et toxiques – le gouvernement français, les agences sanitaires et les associations environnementales redoublent d’efforts pour comprendre, surveiller et limiter leur impact.
Un plan interministériel pour encadrer les PFAS
En janvier 2024, le député Cyrille Isaac-Sibille publie un rapport public intitulé « Per- et polyfluoroalkylés (PFAS), pollution et dépendance : comment faire marche arrière ? ».
Ce rapport contient 18 recommandations, dont l’interdiction des rejets industriels de PFAS, la fixation de valeurs toxicologiques de référence (VTR), et une meilleure information du public.
Ces recommandations présenté le 5 avril 2024. Dans ce cadre, une surveillance renforcée des PFAS dans les stations d’épuration des eaux usées est prévue.
Un projet d’arrêté, soumis à consultation publique jusqu’au 25 avril 2025, prévoit une campagne de prélèvements entre fin 2025 et fin 2026, ciblant les stations d’épuration traitant les eaux de plus de 10 000 équivalent-habitants.
Analyses en cours dans les industries françaises
En parallèle, une campagne de mesures dans les ICPE a été lancée suite à l’arrêté du 20 juin 2023.
Au 25 mars 2025, 2685 installations avaient transmis leurs résultats. Cette opération vise à mesurer au moins 20 PFAS différents et un indicateur global (AOF).
D’après la ministre de la Transition écologique, une surveillance pérenne des substances les plus préoccupantes est envisagée, une fois les résultats consolidés. Des valeurs toxicologiques de référence seront publiées au cours du 1er semestre 2025 par l’ANSES, tandis que des normes de mesure sont à l’étude par l’AFNOR.
Les plus gros pollueurs identifiés
L’association Générations futures, via les données recueillies par les DREAL, a publié le 1er avril 2025 un rapport révélant l’identité des plus gros émetteurs de PFAS en France.
Parmi les 225 sites industriels identifiés, 13 sont particulièrement polluants, dont :
- Arkema France (Pierre-Bénite)
- Solvay (Tavaux)
- Chemours (Villers-Saint-Paul)
- Finorga SAS (Mourenx)
- Euroapi France (Saint-Aubin-lès-Elbeuf)
- Total Energies Raffinage (Donges et Gonfreville-l’Orcher)
…et plusieurs autres, répartis dans toutes les régions.
Fait marquant : 146 sites, soit 5,4 % du total, seraient responsables de plus de 99 % des émissions détectées.
Cependant, l’étude nuance aussi : dans la majorité des cas, les concentrations mesurées sont faibles, parfois dues à l’eau utilisée et non à l’activité industrielle elle-même.
Les stations d’épuration urbaines
Le rapport pointe un risque sous-estimé : de nombreuses ICPE rejettent leurs eaux contaminées dans les stations d’épuration urbaines (STEU), qui ne sont pas conçues pour éliminer les PFAS. Ces stations, en rejetant ensuite leurs boues dans les champs agricoles (épandage), peuvent contaminer les sols et les ressources naturelles.
Une pression citoyenne grandissante
Avec la plateforme « Shake ton politique », Générations futures encourage les citoyens à interpeller les préfets locauxpour qu’ils prennent des mesures contre les industries polluantes. L’objectif est clair : réduire drastiquement les rejets et protéger l’environnement et la santé publique.


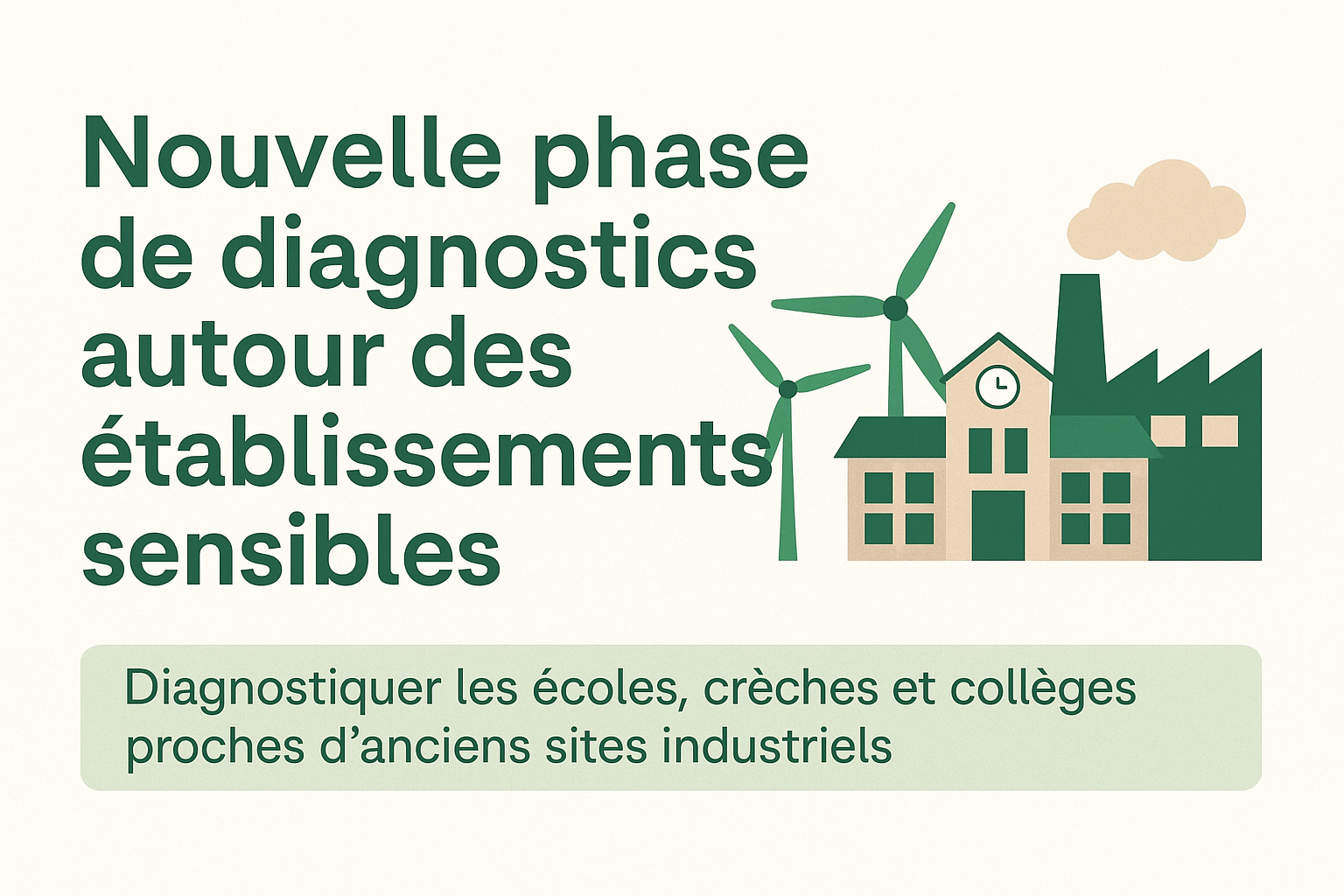
 La consultation est ouverte depuis le 17 septembre 2025
La consultation est ouverte depuis le 17 septembre 2025 À compter du 1er janvier 2026, ces documents devront obligatoirement être transmis au format numérique géoréférencé.
À compter du 1er janvier 2026, ces documents devront obligatoirement être transmis au format numérique géoréférencé. En clair : les cartes des risques deviendront plus lisibles, comparables et intégrables dans des outils numériques communs.
En clair : les cartes des risques deviendront plus lisibles, comparables et intégrables dans des outils numériques communs.